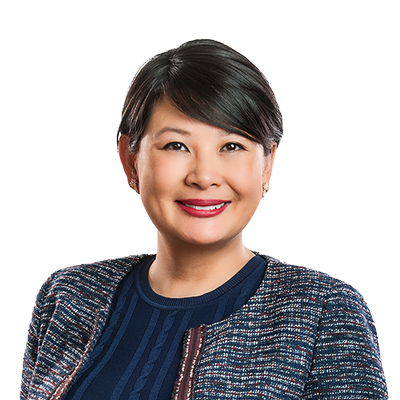L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2.
Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6.
Emboîtant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le 30 novembre 2023 le Projet de loi C-597, qui introduit dans la Loi sur la concurrence8 (la « Loi ») des dispositions visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Amendé le 28 mai 2024, le projet de loi a finalement reçu la sanction royale le 20 juin 2024, date où la Loi est partiellement entrée en vigueur.
Étant donné que ces dispositions s’appliquent à « quiconque », elles visent nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique.
Des modifications à la Loi sur la concurrence visant les déclarations environnementales
La Loi sur la concurrence permet désormais9 au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner10 le comportement d’une personne qui fait publiquement la promotion 1) d’un produit par une déclaration ou une garantie environnementale11 ou 2) d’intérêts commerciaux quelconques par des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise sur l’environnement.
Déclaration concernant un produit ou un service
Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages de ce produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui lui sont attribuables, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire12 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.
À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service13.
De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14.
Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15.
En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :
traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17.
Rappelons que les indications accompagnant un produit qui proviennent d’une personne qui est à l’étranger sont réputées être données par la personne qui a importé le produit au Canada18.
Déclarations générales à l’égard des activités d’une entreprise
Alors que le projet de loi C-59 ne visait initialement que les déclarations ou garanties environnementales à l’égard de produits, la version sanctionnée de celui-ci prévoit que toutes indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques sont susceptibles d’examen par le Bureau19.
À titre d’exemple cité par le Bureau, constitueraient des « indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’atténuation des causes des changements climatiques » une prétention voulant qu’une entreprise soit « carboneutre » ou qu’elle s’engage à le devenir d’ici un certain nombre d’années20.
L’entreprise qui fait de telles allégations devra être en mesure de démontrer que celles-ci se fondent sur des éléments corroboratifs « suffisants et appropriés » obtenus au moyen d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale »21. La Loi ne précise pas quelles méthodes reconnues à l’échelle internationale peuvent être utilisées à cette fin.
Advenant que la preuve sur laquelle se fonde l’entreprise soit insuffisante, inappropriée ou obtenue au moyen d’une méthode non reconnue à l’international, celle-ci sera exposée aux mêmes conséquences que celles mentionnées dans la section précédente22.
Rappelons que, peu importe la nature des déclarations, que ce soit celles concernant un produit ou un service ou celles concernant les activités d’une entreprise, la Loi permet aux personnes visées de faire valoir, à titre de défense, une preuve de diligence23.
Quelles seront les véritables incidences de ces modifications?
Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique24. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important25.
Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Certaines ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits26/27/28/29.
Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau.
Les modifications à la Loi envisagées changent la donne en ce qu’elles ont pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques ou de faire la preuve que ses indications se fondent sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale.
Vérification faite, les nouvelles dispositions sont de nature à confirmer, dans des dispositions législatives particulières, ce que la norme générale consacrait déjà depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau.
Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur30. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment31.
L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés32. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement33. Des sanctions pénales34 et civiles35 sont prévues en cas d’infraction.
Recours privé
Autre nouvelle mesure de lutte contre l’écoblanchiment apportée à la Loi sur la concurrence : la possibilité désormais pour toute personne (un citoyen, un organisme, une entreprise concurrente, etc.) de déposer directement une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence à l’encontre d’une entreprise qui fait des déclarations ou donne des indications environnementales à l’égard d’un produit, d’un service ou de ses activités sans preuve suffisante à l’appui36. Dans la première version du projet de loi C-59, seul le commissaire du Bureau pouvait entreprendre un tel recours devant le Tribunal37.
Une telle demande devra toutefois être préalablement autorisée par le Tribunal de la concurrence38. Le pouvoir du Tribunal d’autoriser une telle demande est largement discrétionnaire, c’est-à-dire que le Tribunal pourra y faire droit s’il considère que cela servirait l’intérêt public39.
À noter que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans un an, soit le 20 juin 202540.
Les pratiques exemplaires
Il est crucial pour une entreprise d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.
Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise, mais également à ses relations avec ses parties prenantes.
Avant de communiquer une image « verte », une introspection est nécessaire.
Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le conseil d’administration? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés?
Considérations relatives aux sociétés publiques
En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés publiques assujetties à des obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « émetteurs assujettis »), ces considérations s’inscrivent dans un contexte de pression grandissante de la part des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels et d'autres parties prenantes, pour une plus grande transparence à l’égard des enjeux liés aux questions climatiques.
Bien que les exigences de divulgation d'informations sur les questions climatiques applicables aux émetteurs assujettis canadiens soient encore relativement limitées, de nombreux émetteurs choisissent de communiquer volontairement de telles informations, par exemple dans le cadre de rapports sur le développement durable.
Les émetteurs assujettis doivent porter une attention particulière à leurs communications, lesquelles pourraient constituer de l’écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence et engendrer les sanctions et autres conséquences mentionnées précédemment. Ce risque s’ajoute, bien sûr, à la responsabilité des émetteurs assujettis sur le marché secondaire liée à des déclarations trompeuses et au défaut de divulgation en temps opportun.
En ce qui concerne les questions climatiques, ce risque découle notamment d'une surestimation ou d'une divulgation inadéquate de l'impact positif de leurs activités sur la protection de l'environnement ou de l'atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui leur sont imputables.
Le mouvement actuel en faveur de l'adoption de méthodologies et de cadres standardisés ainsi que l’adoption prochaine de règles contraignantes en matière de divulgation d’information liée aux questions climatiques devraient contribuer à limiter les problèmes d’écoblanchiment dans ce contexte.
Dans l’intervalle, les émetteurs assujettis peuvent réduire les risques d’écoblanchiment en suivant une méthodologie bien établie à l’échelle internationale et en s’assurant d’inclure des clauses de non-responsabilité en ce qui concerne l’information prospective, lesquelles sont adaptées aux risques et aux incertitudes applicables à l’information fournie au sujet des questions climatiques.
Conclusion
Les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence ont déjà commencé à avoir des effets. Des entreprises ont, par prudence, retiré publicités, documents promotionnels et sites Web vantant des activités dont l’objectif déclaré était de lutter contre les changements climatiques.
Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise ne reposait sur rien de tangible.
Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca).
Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca)
Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures.
Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr).
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu).
Pour consulter: KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com)
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter: Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes.
L.R.C. 1985, c C-34
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 juin 2024.
Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, à la réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence, voir L.R.C. 1985, c C-34, articles 9 et 10.
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute les paragraphes (b.1) et (b.2) à l’alinéa 74.01(1) de la Loi.
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1.
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, alinéa 2(1).
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1), pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada.
La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss.
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province.
La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2.
Loi sur la concurrence, LRC 1985 c C-34, alinéas 74.03 (1) et (2).
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’alinéa (b.2) de l’article 74.01 de la Loi a été ajouté par un amendement adopté le 28 mai 2024.
Lettre d’Anthony Durocher et Bradley Callaghan destinée à l’honorable Pamela Wallin datée du 31 mai 2024, pour consulter : BANC_Follow-up_CompetitionBureau_e.pdf (sencanada.ca).
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1.
Loi sur la concurrence, alinéa 74.1(3).
Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca).
Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, alinéa 74.01 (a);
Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse.
Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse
Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca.
Le commissaire de la concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13.
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 219, 220 et 221.
Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca)
Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 46 à 57.
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 220 et 221.
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Id., articles 271 à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation.
Pour les matières civiles uniquement; Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254(1).
Voir l’alinéa 103.1 (1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vigueur avant le 20 juin 2024.
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254 (1).
Id., alinéa 254 (4).
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 272.